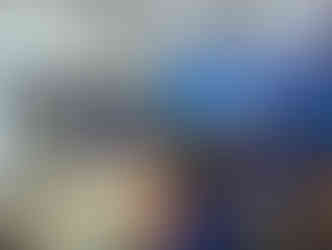Jeunesse Shonan Academy : la vision d’Ibrahim Ouazzani pour réinventer la formation au Japon
- Simon Arnaudet
- 12 janv.
- 12 min de lecture
Pour la troisième fois après l’international cambodgien d’origine ivoirienne Abdel Kader Coulibaly et le défenseur belgo-rwandais Dylan Maes, la rubrique Les Frenchies s’ouvre à un francophone au parcours singulier. Il arrive en effet de croiser des profils atypiques, qui ne ressemblent à aucun autre, et Ibrahim Ouazzani en est l’illustration parfaite. Marocain, ayant grandi au Gabon avant de vivre en Espagne puis en France, il parle cinq langues et nourrit une passion : le beau football, celui qui émeut le spectateur. Issu du football de rue, il estime devoir sa vie entière à ce sport, à travers lequel il a trouvé ses amis, ses voyages, et l’opportunité de jouer, d’entraîner, de se former et d’apprendre. Installé au Japon depuis plusieurs années, il se définit aujourd’hui comme un « accompagnateur » de joueurs et un « facilitateur » de l’émergence des talents au pays du Soleil-Levant, une vision qu’il a concrétisée la saison dernière en fondant sa propre structure : la Jeunesse Shonan Academy.

Quel est le moment où tu t’es dit : “Je suis exactement là où je dois être” dans le football japonais ?
C’est une question difficile à laquelle répondre, car le Japon est un pays à part entière, dont la culture est difficilement assimilable pour ceux qui n’y ont pas grandi. Cela m’a pris — et me prend d’ailleurs toujours — beaucoup de temps pour comprendre réellement le football dans ce pays. Un de mes formateurs en Argentine m’avait dit un jour : « se juega como se vive », que l’on peut traduire par « on joue comme on vit ». Cela peut sembler être une phrase banale, facilement interprétable. Pourtant, après toutes ces années de voyages et d’expériences, je vis littéralement à travers cette idée. Elle signifie que pour comprendre un « football », il faut comprendre l’histoire qu’il y a derrière. Et pour comprendre une façon de vivre comme celle du Japon, cela demande du temps. À plusieurs étapes de mon parcours au Japon, je me suis dit que j’étais exactement là où je devais être. Mais c’est un sentiment qui varie constamment en fonction du degré d’assimilation de la culture. Plus on la comprend, plus la perception du moment présent évolue, et plus on remet en question la pertinence d’être à tel endroit — que ce soit en termes de catégorie d’âge ou de localisation — dans le développement des joueurs. Pour illustrer cela, j’ai été impliqué dans des centres très réputés du pays, comme le FC Kokoku ou encore Higashiyama, qui sont plus précisément des lycées. Nous y accueillions généralement des joueurs de la première à la troisième année, soit de 16 à 18 ans. Lors de mes débuts au Japon, la première chose qui m’a frappé était leur attitude : des joueurs très à l’écoute, désireux d’apprendre, prêts à fournir beaucoup d’efforts. C’est d’ailleurs l’image que beaucoup d’entraîneurs étrangers ont du footballeur japonais. Mais avec le temps, j’ai compris que ce comportement est avant tout le fruit de ce que leur culture exige d’eux. Ils sont, en quelque sorte, conditionnés à écouter et à faire ce qu’on leur demande. C’est évidemment positif, mais cela entraîne aussi des dérives. Les joueurs écoutent parce qu’ils y sont obligés, reproduisent parce que c’est ce qu’on leur a appris à faire, mais sont rarement capables de contre-argumenter, de demander « pourquoi », ou de s’approprier réellement un apprentissage. On se retrouve alors avec des profils qui ne vivent pas le football comme en Europe, en Afrique ou en Amérique du Sud, où les joueurs s’expriment, ressentent, créent et produisent. Le football japonais, lui, tend davantage vers l’effort, le sacrifice et l’exécution. Les joueurs ont besoin d’être instruits et de reproduire ce qu’on leur demande. Pour eux, le football est avant tout une histoire d’efforts permanents, de dépassement de soi — « gambare », comme on dit en japonais. On en oublierait presque que c’est un jeu. Ils n’ont pas été formés à prendre du plaisir en s’exprimant, à mener des réflexions personnelles, à créer, proposer, donner leur avis pour enrichir les échanges. Or ce sont précisément ces qualités que je juge essentielles et que je cherche à valoriser. Durant mes sept années dans ces académies, nous avons obtenu des résultats concrets : chaque saison, environ cinq joueurs devenaient professionnels au Japon, et nos équipes partaient régulièrement en stage dans des clubs européens (France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas). Il s’agissait de joueurs très propres techniquement, disciplinés tactiquement, de très bons footballeurs. Mais, j’y reviendrai plus tard, ils ne correspondent pas aux exigences du très haut niveau européen. Ces sept années ont aussi profondément changé ma perception du Japon, notamment grâce à l’acquisition de la langue. Parler japonais m’a permis de comprendre beaucoup plus finement les relations humaines, car jusque-là, ma compréhension était filtrée. J’ai alors saisi la rigidité du système hiérarchique japonais, le kohai/senpai, perceptible notamment à travers l’usage constant des honorifiques. Puis, aux alentours de ma quatrième année, j’ai découvert ce que l’on appelle ici le « power hara », que l’on peut traduire par « harcèlement par le pouvoir ». De manière très simple, lorsqu’une personne détient une forme de supériorité — par sa position, son âge ou son statut — elle peut exercer une pression morale, voire un harcèlement. Cela existe dans de nombreuses entreprises, établissements scolaires et, bien sûr, dans le football. Dans les académies japonaises, ce sont souvent les entraîneurs qui exercent cette pression sur les joueurs, en les dévalorisant constamment. Or la culture japonaise ne prépare pas les individus à se défendre face à ce type de violence morale. La majorité subit. J’ai également compris qu’au Japon, il n’existe que très rarement de véritables projets de formation chez les jeunes. Certains clubs commencent à se structurer et à planifier l’intégration progressive de joueurs issus de leurs centres, mais pour beaucoup, l’objectif principal reste de gagner. Attirer de bons joueurs, remporter des compétitions, bénéficier de visibilité médiatique. Les équipes victorieuses attirent les meilleurs talents, qui sont alors utilisés pour gagner, plutôt que réellement formés pour progresser vers le professionnalisme. Les joueurs sont au service de l’entraîneur, et non l’inverse. Ces compétitions sont souvent diffusées à la télévision et génèrent de très fortes audiences nationales. Pourtant, lorsqu’on les observe de près, peu d’équipes cherchent réellement à jouer. Beaucoup refusent le jeu, abusent des dégagements, des longs ballons, des blocs défensifs très bas. Et pour quelqu’un comme moi, qui souhaite transmettre le plaisir de jouer, le beau jeu, et donner aux joueurs les clés pour comprendre le football et en aimer la complexité, j’ai fini par réaliser que je n’étais plus à ma place avec cette catégorie d’âge. J’ai compris qu’il était trop tard pour leur apprendre à ne pas simplement exécuter des consignes, mais à se les approprier, à les adapter à leur jugement et à la situation. Trop tard aussi pour leur transmettre l’envie de bien jouer, car tout ce qu’on leur avait inculqué jusque-là, c’était que gagner était l’unique priorité, et qu’ils n’étaient pas destinés à penser par eux-mêmes sur un terrain.

Qu’a changé le Japon dans ta manière de penser le football, mais aussi de penser l’humain ?
Ma manière de penser le football n’a jamais changé. J’ai toujours souhaité promouvoir le beau jeu, parce que pour moi, le football doit procurer des émotions, émouvoir le spectateur. Je l’ai toujours perçu comme un jeu, et je continuerai à le faire, tout simplement parce que ça l’est. En revanche, le Japon m’a permis d’assimiler et d’accepter qu’il existe des perceptions très différentes du football à travers le monde. Ici, jouer au football ne rime pas forcément avec liberté d’expression, mais davantage avec efforts permanents, travail et répétition. Pour beaucoup de Japonais, je pense que c’est précisément cela qui suscite l’émotion : voir des joueurs se battre de toutes leurs forces pour arracher un résultat. De mon côté, ce qui m’émeut profondément, c’est autre chose. C’est voir des joueurs s’amuser sur le terrain, la beauté du geste, les combinaisons, le mouvement permanent. C’est cette dimension-là du football que je continuerai toujours à défendre, car c’est elle qui, selon moi, donne tout son sens au jeu.
Peux-tu présenter la Jeunesse Shonan Academy ?
La Jeunesse Shonan Academy est une académie que j’ai décidé de fonder parce que la raison pour laquelle j’avais été recruté au Japon en 2018 était de préparer et de promouvoir de jeunes joueurs talentueux vers l’Europe. En sept ans, nous avons envoyé 16 garçons en stage dans des clubs européens de première division. Les retours des clubs étaient quasiment toujours les mêmes : des joueurs très propres techniquement, généreux dans l’effort, disciplinés tactiquement, mais qui manquaient d’initiative. À cela s’ajoutaient des difficultés linguistiques — ils ne parlaient que japonais — et d’importants décalages culturels, rendant leur intégration très compliquée. Les joueurs n’étaient tout simplement pas préparés à ce passage, et les trois années dont je disposais pour combler ces retards me semblaient insuffisantes. J’ai donc décidé de monter un projet avec une réelle orientation vers l’intégration en Europe, ce qui, compte tenu du système japonais actuel, impliquait de commencer beaucoup plus tôt, en recrutant des enfants de 10 à 12 ans. Au Japon, il existe des ligues et des compétitions dès les U10, et 99 % des enfants sont encadrés par des entraîneurs souvent non qualifiés — parfois des parents — qui leur inculquent avant tout la discipline, la mentalité et la victoire à tout prix. Les joueurs apprennent donc l’importance de gagner dès leur premier contact avec le football, ce qui se traduit sur le terrain par des longs ballons, des dégagements permanents et des entraîneurs qui crient sur les enfants. Même dans les équipes qui cherchent à jouer, tout est dirigé par l’entraîneur, avec des consignes constantes, comme si l’on essayait de faire du Guardiola avec des U10. Il y a très peu de place laissée à l’initiative, et je considère cela comme un immense gâchis, car ces enfants sont souvent très doués et pourraient bien mieux s’exprimer dans un environnement adapté à leur développement. C’est précisément pour répondre à ce constat que j’ai créé l’académie. Aujourd’hui, elle accueille 16 garçons sélectionnés parmi environ 8 000 joueurs observés dans la région de Shonan, située dans la préfecture de Kanagawa. Pour moi, former, ce n’est pas avoir beaucoup de joueurs, mais avoir de bons joueurs. J’ai également ajouté un filtre spécifique : la capacité à renoncer au système japonais classique — tournois, ligues, compétitions scolaires — pour se consacrer pleinement à leur progression. Cette exigence vient d’une observation récurrente : beaucoup de joueurs disent vouloir tenter leur chance en Europe, mais hésitent dès qu’un essai coïncide avec un tournoi local. Cette hésitation m’a beaucoup interrogé sur la puissance du système et sur une forme de faiblesse mentale, car de nombreux joueurs ailleurs dans le monde saisiraient cette opportunité sans réfléchir. Les profils de l’académie ont donc été soigneusement sélectionnés. Mon approche n’est pas basée sur l’instruction directe, mais sur ce que j’appelle la « pédagogie des situations problèmes » ou « l’approche écologique ». J’ai besoin de joueurs dotés d’une intelligence naturelle. Mes interventions pendant les séances sont limitées, avec des consignes simples, claires et générales. Toutes les séances, du début à la fin, sont construites autour de jeux sur espaces réduits — conservation, mini-matchs en 4 contre 4 ou 5 contre 5 — avec des règles visant à favoriser certains comportements. Je pars du principe que les joueurs sont intelligents et que la situation les contraint à trouver des réponses simples mais aussi créatives. La complexité est définie par les règles, les consignes et les joueurs eux-mêmes, qui, par leur intelligence, augmentent naturellement le niveau d’exigence et s’auto-contraignent à trouver des solutions. Les échanges et les feedbacks ont lieu avant et après l’entraînement, sous forme de discussions collectives, sans que les réponses ne viennent de moi, car je cherche à développer leur autonomie dans la réflexion. Je n’essaie pas de me placer comme un instructeur, mais comme un accompagnateur. Le volume d’entraînement est important, les coupures sont courtes, il y a beaucoup de continuité, et l’esprit de compétition est présent puisque tout se joue. J’ai constaté que les joueurs ne se fatiguent pas de jouer, mais se fatiguent très vite de travailler lorsque les exercices n’ont pas de sens. Ici, on joue au football, et j’exclus autant que possible le mot « travail ». C’est une approche radicalement différente au Japon — et même en France — dont l’inspiration vient principalement d’Argentine, avec l’héritage du barrio et du potrero, cette pratique libre sur les terrains vagues. Un formateur argentin m’avait dit un jour que ces terrains avaient fait les beaux jours de nombreux clubs européens, car on ne forme pas des joueurs en les instruisant, mais en les laissant jouer et en les questionnant. Cette approche porte déjà ses fruits : les joueurs osent, créent, produisent, et les clubs comme les scouts japonais et européens qui viennent nous voir sont souvent surpris par la fluidité du jeu, la créativité et la personnalité de certains profils. L’académie a débuté en 2025, avec cette première promotion, et même s’il reste encore énormément de défis à relever avant les premiers départs, la direction est claire.

Quelle est la plus grande idée reçue que les Européens ont sur le football japonais ?
Je pense que la plus grande idée reçue concerne leur supposée faiblesse dans les duels aériens, et notamment dans le jeu de tête. Beaucoup d’Européens estiment que les joueurs japonais ne sont pas performants dans ce domaine, alors que, de mon point de vue, c’est faux. Je trouve au contraire qu’ils sont efficaces dans le jeu aérien, bien plus qu’on ne l’imagine depuis l’extérieur.
Y a-t-il une habitude japonaise que tu aimerais importer dans les centres de formation européens ?
Une habitude japonaise que j’aimerais éventuellement importer dans les centres de formation européens, c’est la capacité d’écoute. Dans ce domaine, les Japonais sont irréprochables : lorsque quelqu’un parle, les joueurs se taisent et écoutent de manière active. Cette qualité est extrêmement forte et crée un cadre très respectueux. Par ailleurs, dans certaines équipes, les joueurs effectuent des cris de guerre avant l’entraînement afin de se motiver et de se mettre dans l’état d’esprit de tout donner pendant la séance. Je trouve cela plutôt positif, et ce sont des pratiques simples qui mériteraient d’être testées et adaptées dans les centres de formation européens.
En Europe, on parle beaucoup de “winning mentality”. Au Japon, quel est le mot ou concept clé qui résume la philosophie de formation ?
Je pense qu’au Japon, le concept qui résume le mieux la philosophie de formation est celui de la résilience. Les joueurs en formation sont contraints de développer cette capacité au quotidien : voyages fréquents, volumes de matchs très importants, calendriers annuels extrêmement chargés entre les cours, les déplacements, les devoirs, les compétitions et les différentes obligations. Il y a très peu de repos, ce qui augmente mécaniquement les risques de blessures. Je me souviens par exemple de nos tournées européennes : après vingt-quatre heures de vol, nous arrivions à l’aéroport, partions immédiatement visiter la ville, déposions les valises, puis rejouions un match… le jour même de notre arrivée. Le lendemain, quatre heures de bus vers une autre ville, puis un nouveau match, et ainsi de suite pendant dix jours. Cela peut sembler surprenant, mais c’est profondément ancré dans la culture japonaise. J’ai aussi des souvenirs de tournois estivaux au Japon, avec des coups d’envoi à 13h sous des températures, une humidité et un niveau d’UV extrêmement élevés. Malgré ces conditions, les joueurs évoluent à haute intensité. Beaucoup d’équipes ailleurs refuseraient tout simplement de jouer dans de telles circonstances, ce qui explique pourquoi, selon moi, la résilience est une notion centrale dans la formation japonaise. Une autre idée très forte est celle de « gagner avant tout ». On pense souvent que la winning mentality atteint son paroxysme en Europe, mais d’après mon expérience, au Japon, on franchit encore un palier. Il existe parfois un refus total de jouer et de prendre des risques, avec des systèmes très rigides, les mêmes joueurs aux mêmes postes, et un football extrêmement réducteur : refus de jouer dans son camp, dégagements systématiques vers l’avant, puis intensité maximale sur les deuxièmes ballons pour aller le plus vite possible vers le but. À mes yeux, c’est un football anti-formation, mais c’est pourtant une réalité très présente dans le paysage de la formation japonaise.
Le modèle académique asiatique peut-il vraiment concurrencer le modèle européen, ou va-t-il créer quelque chose de totalement différent ?
Actuellement, certains clubs japonais tentent de copier les modèles académiques européens. Cependant, comme je l’ai mentionné précédemment, il n’existe pas réellement d’objectif clair et assumé de développer des joueurs professionnels comme c’est le cas dans les académies performantes en Europe ou en Amérique du Sud. Il ne s’agit pas, à mon sens, de véritables projets de formation, car beaucoup de choses restent conditionnées par les résultats des équipes. Au Japon, la formation n’est pas détachée de la performance sportive immédiate : les deux sont intimement liées, ce qui empêche souvent de placer le développement du joueur au centre du projet sur le long terme.
L’histoire de Ibrahim Ouazzani est d’abord celle d’un passionné. Un homme qui, depuis sa plus tendre enfance, aime le football plus que tout. C’est aussi l’histoire d’un parcours multiculturel, d’un esprit curieux de tout et de tous, qui s’inspire des meilleurs exemples où qu’ils se trouvent. Enfin, c’est celle d’un homme ambitieux, qui cherche, analyse, remet en question et donne le maximum, non pas pour simplement vivre une belle vie, mais pour changer les choses et laisser une trace durable dans le domaine qu’il aime tant : le football. Son ambition d’apporter une nouvelle philosophie de jeu au Japon est particulièrement audacieuse. Mais sans audace, qu’aurait fait Valeri Lobanovski ? Seul l’avenir dira si Ibrahim Ouazzani a compris quelque chose que d’autres ne voulaient pas voir. Mais une chose est certaine : le football est plus beau avec des personnages comme lui.
---
Simon Leon, copywriter, rédacteur et community manager.
Crédits photo : Ibrahim Ouazzani et la Jeunesse Shonan Academy